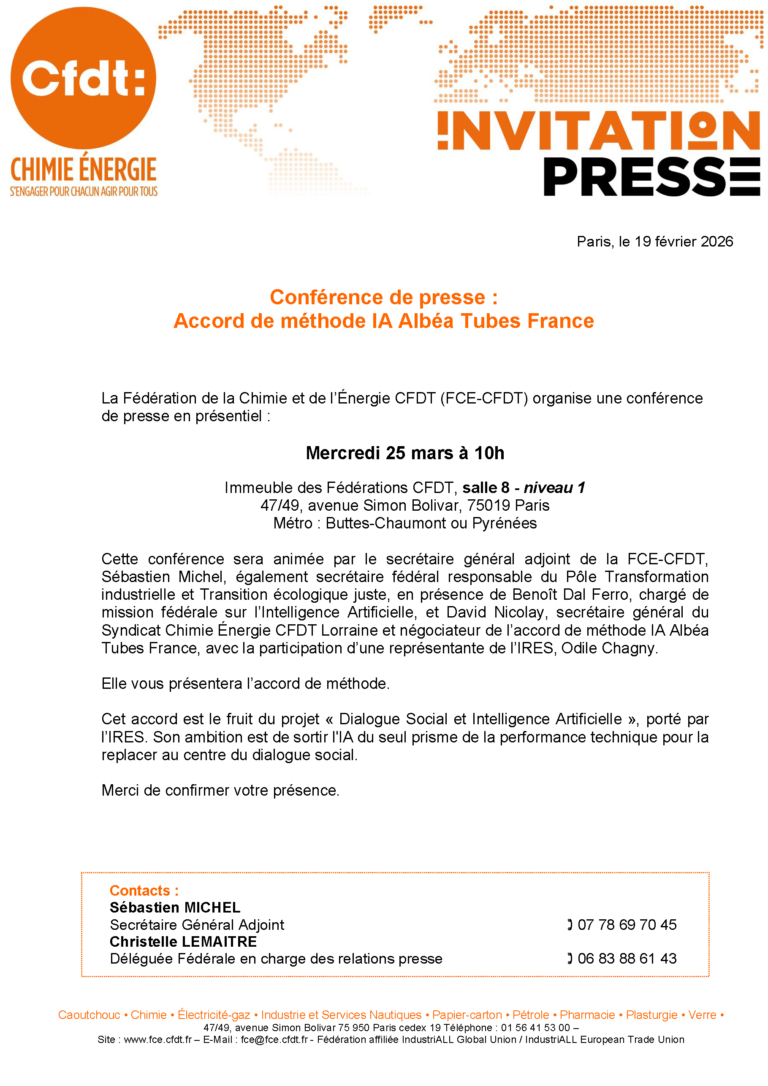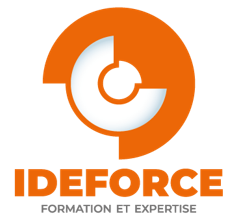A la demande du Comité d’entreprise européen de Gaz de France, sous l’impulsion de la délégation CFDT, l’association Idéforce et le cabinet Syndex ont réalisé une expertise sur les conséquences sociales en Europe d’une fusion entre Gaz de France et Suez, dans les services énergétiques. Expertise qui aura contraint la direction de Gaz de France à reconnaître les réductions de postes envisagées et qui sera, en cas de rapprochement des deux groupes après le 1er juillet 2007, un appui aux futures négociations.
« N’ayez crainte, Gaz de France et Suez s’engagent à ce que la fusion se réalise sans aucun licenciement économique. » Depuis l’annonce du projet de fusion, et à chaque interpellation de la CFDT sur les conséquences que cette fusion aurait sur l’emploi, les directions des deux groupes n’avaient de cesse de répéter ce discours rassurant. Mais licenciement ne signifie pas suppressions de postes ! Interrogées par les experts, elles admettent tout de même que ce sont quelques 300 réductions d’emplois, dans les services énergétiques en France et en Italie, qui ont été calculées dans les « synergies opérationnelles » justifiant la fusion, à hauteur de 30 millions d’euros ! Aujourd’hui, l’expertise montre que cette affirmation vaut sous condition de mobilité des salariés, mobilité géographique mais aussi fonctionnelle.
Autre conclusion de l’expertise menée, les conséquences sociales d’une fusion entre les deux groupes se jouent à deux niveaux. Tout d’abord, au regard des sièges et des agences des deux groupes situées dans les mêmes villes. Jusqu’à 700 emplois-doublons sont ainsi directement menacés. Qu’il s’agissent des fonctions-supports (comptabilité, ressources humaines, informatique, etc.) des sièges et des agences des sociétés Cofathec et Elyo, en France et en Italie (mais aussi, dans une moindre mesure, en Angleterre et en Belgique) et des sociétés ADF, Axima, Endel, Oméga et Seitha, en France.
Ensuite, des conséquences sociales importantes, à moyen terme, liées indirectement à la fusion, peuvent d’ores et déjà être identifiées. Elles relèvent des stratégies du futur ensemble éventuel. Dans les services énergétiques, la taille plus importante de Suez laisse envisager que les stratégies menées, à ce jour, dans la branche Services énergétiques pèseraient largement sur les choix de demain. Certaines sociétés sont aujourd’hui sous surveillance pour cession éventuelle, car n’ayant pas d’assez bons résultats en termes de rentabilité ou ne s’inscrivant pas dans la stratégie de la branche de Suez (c’est le cas d’Endel). Déjà existants dans certaines filiales de Suez, les centres de services partagés (regroupement des fonctions-supports sur un seul site) pourraient aussi être généralisés au niveau de la future branche Services énergétiques.
CoEE de Gaz de France
Résultat d’âpres négociations, l’accord fondateur du Comité d’entreprise européen de Gaz de France a été signé en 2001. Le Comité est informé et consulté sur tout projet ayant une dimension transnationale, ou relevant d’une décision du groupe. Il rassemble 32 représentants, issus de 8 pays européens. 3 membres y représentent la CFDT.
« SERVICES » : DE QUOI PARLE-T-ON?
Il s’agit d’un terme générique qui désigne deux grands groupes de métiers, aux contraintes et aux caractéristiques différentes. D’un côté, les services énergétiques proprement dits, regroupant l’exploitation thermique et l’entretien d’installations techniques ou climatiques, sur la base de contrats généralement longs (sociétés Cofathec Services, Coriance, Elyo). Ces marchés sont en développement. De l’autre, les activités de travaux regroupant les métiers d’installation, aux carnets de commande de court terme et aux risques accrus (sociétés ADF, Axima, Endel, Ineo, Omega, Seitha). Ces marchés sont de moindre rentabilité. Dans Gaz de France, les services représentent 10 % du chiffre d’affaires du groupe (1,9 Mde), 25 % des effectifs (12 545 personnes) et 4 % de la marge opérationnelle. Les services énergétiques, principalement en France et en Italie, en représentent 75 % du chiffre d’affaires. Chez Suez, les services représentent 25 % du chiffre d’ affaires du groupe (9,9 Mde), 40 % des effectifs (65 024 personnes) et 9 % du résultat opérationnel. Les métiers d’installation, principalement en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, en représentent 55 % du chiffre d’affaires.
3 QUESTIONS A… Jean-Luc Rigo, représentant CFDT au Comité d’entreprise européen de Gaz de France
QUEL RÔLE LES REPRÉSENTANTS CFDT AU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN DE GAZ DE FRANCE ONT-ILS JOUÉ DANS LE PROJET DE FUSION AVEC SUEZ ?
Depuis l’annonce du projet de fusion, le CoEE (NDLR. Comprendre le Comité d’entreprise européen) de Gaz de France s’est réuni pour information, à quatre reprises. Tout au long de l’année 2006, la CFDT a abordé le projet sans préjugé, ni dogmatisme. Le souci des représentants CFDT a été, et restera, de concilier avenir de l’entreprise et intérêt des salariés.
Dès la première réunion en mars 2006, nos interventions ont été centrées sur l’emploi. Au-delà du discours rassurant des directions, et même si un rapprochement avec Suez a un sens industriel, nous voulions des garanties pour l’emploi dans le groupe, et nous n’avons eu de cesse d’interroger les directions sur les conséquences de cette fusion sur les emplois.
Les réponses à nos questions sur les effectifs du futur groupe restant évasives, nous avions dès le mois de mai, proposé aux membres du CoEE de mandater un expert pour approfondir les impacts de la fusion sur l’emploi. Jugeant cette expertise prématurée dans un premier temps, les membres du CoEE nous ont rejoints en novembre, quand les directions ont présenté un dossier ne réservant à l’emploi dans le futur groupe qu’une demi-page inconsistante. Aucun élément chiffré précis n’était donné, aucune information sur le traitement des éventuels doublons.
Les représentants CFDT avaient anticipé ce scénario, et préparé un cahier des charges sur ce que les salariés étaient en droit de connaître pour leur avenir. Quand la direction a demandé l’avis du CoEE sur le projet de fusion, le CoEE a alors mandaté l’association Idéforce et le cabinet d’expertise Syndex pour réaliser une étude sur l’impact de la fusion sur l’emploi dans le métier des services énergétiques.
LA DIRECTION A-T-ELLE ACCEPTÉ CETTE EXPERTISE ?
Non, elle considérait l’information suffisante, et a refusé l’expertise. Le CoEE est donc allé en référé, s’appuyant sur un article de l’accord instaurant le CoEE. Article précisant que le CoEE doit, pour tout projet exceptionnel susceptible d’avoir des conséquences pour les salariés, « être consulté dans un délai suffisant pour que les éléments du débat ou l’avis du CoEE puissent être intégrés au processus de décision ».
Le tribunal, fondant sa décision sur le manque d’information dont l’absence de réponse aux demandes renouvelées de la CFDT sur l’avenir de l’emploi en France comme en Europe, a donné raison au CoEE tant en référé qu’en appel, et a suspendu le processus de fusion dans l’attente du résultat de l’expertise. Cette décision est d’importance pour la jurisprudence, car elle reconnaît le rôle du CoEE dans un processus décisionnel. La direction s’est d’ailleurs pourvue en cassation. La décision finale devrait intervenir avant juin 2007.
L’EXPERTISE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AU COEE. QUEL USAGE ALLEZ-VOUS EN FAIRE ?
L’étude a montré que, contrairement à ses allégations, la direction avait bien examiné l’impact de la fusion sur l’emploi, et que les synergies financières dégagées prenaient bien en compte des réductions d’effectifs. La direction nous mentait donc, quand elle affirmait qu’il lui était impossible, à ce stade du dossier, d’évaluer les effets de la fusion sur l’emploi.
Idéforce et Syndex, bien que disposant d’une information parcellaire, ont réussi à chiffrer cet impact. Il apparaît que 720 emplois sont menacés dans les fonctions- supports des seuls services énergétiques, auxquels il convient a minima d’ajouter les doublons des sièges centraux. Nos collègues anglais et italiens (chez qui, il n’y a pas de comité d’entreprise, donc pas d’expertise) peuvent ainsi mieux évaluer les risques de suppressions de postes dans leurs entreprises, filiales du groupe Gaz de France. Quant à elles, les directions vont devoir annoncer les mesures concrètes qu’elles envisagent en matière de formation, d’accompagnement de la mobilité ou d’intégration dans d’autres unités du groupe…
De notre côté, nous possédons aujourd’hui des éléments qui nous permettraient de négocier des mesures spécifiques en cas de fusion. Mais nous continuons à nous battre pour mettre en œuvre la solution alternative que nous proposons, à savoir les participations croisées entre les deux groupes qui, non seulement permettraient de préserver l’emploi, mais aussi de garantir l’avenir et le développement des deux groupes.